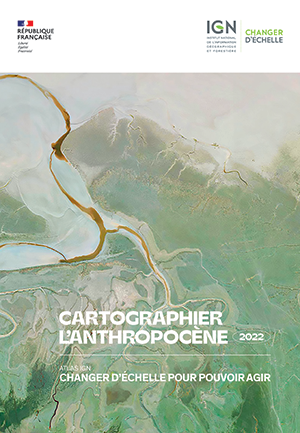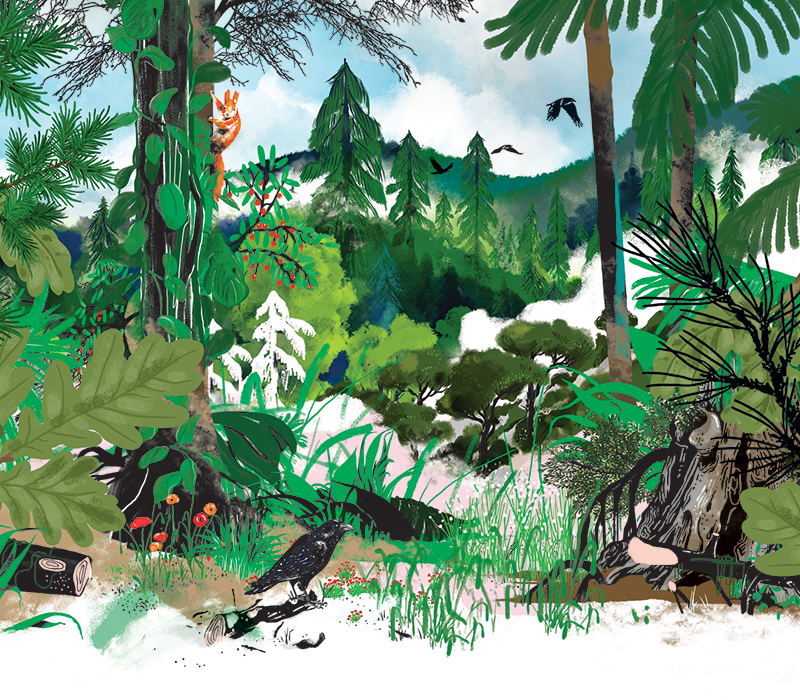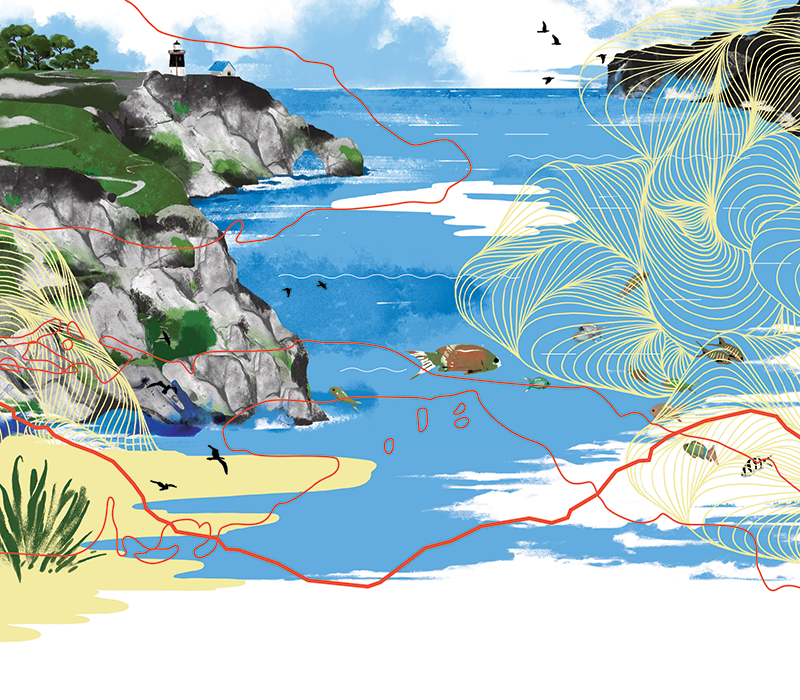Changer d'échelle pour pouvoir agir
L'IGN publie son premier atlas des cartes de l'anthropocène. Une invitation à changer d'échelle pour pouvoir agir.
L’été 2022 a été marqué par l’intensité et la succession de records de chaleur, sécheresse, méga-feux de forêts, inondations et épisodes de vent violents.
Face à ces bouleversements, l’IGN, dans sa mission d’appui aux politiques publiques, s’est engagé en 2021 à développer une capacité d’observation en continu. L’enjeu : produire des cartes thématiques sur un nombre limité d’enjeux écologiques majeurs qui rendent compte des changements rapides du territoire et des conséquences sur l’environnement.
La carte, sous toutes ses formes, est un extraordinaire outil de médiation et de compréhension du monde. Les cartes de l’anthropocène permettront ainsi d’établir des diagnostics partagés et d’offrir des outils mobilisables par les acteurs pour parler un langage commun et relever les défis environnementaux.
Par ce premier atlas, qui a vocation à devenir un rendez-vous annuel, l’IGN présente ses cartes de l’anthropocène et décrit les enjeux technologiques pour les produire et cartographier les changements.


Mobiliser diverses sources de données pour enrichir la description de l’anthropocène
À travers une mission « mixte technologique », l’IGN investigue les nouvelles possibilités d’acquisition et de combinaison de données à mobiliser en fonction des besoins (prises de vues aériennes, observations satellites, levés terrains, acquisitions LiDAR et radar aéroportées). Concernant les techniques d’acquisition, l’IGN renforce son expertise en matière de géolocalisation (positionnement d’objets type « GPS ») afin de mieux prévenir et gérer les risques induits par les changements environnementaux (glissements de terrain, déformation des bâtiments).
En savoir plusTraiter rapidement les données afin de montrer les phénomènes dans le bon timing
L’institut a fait le choix de s’investir dans le déploiement de l’intelligence artificielle (deep learning ou apprentissage profond) pour automatiser ses chaînes de production initiales et accélérer le traitement des images (reconnaissance automatique des objets du terrain). Utilisé à bon escient, l’apprentissage machine peut jouer un rôle majeur dans l’élaboration de réponses à la transition écologique.
En savoir plusMontrer les données sous des formes adaptées à la prise de décision publique et accessibles à tous
La mobilisation des techniques de datavisualisation va permettre à l’IGN, qui s’est saisi du sujet, d’adapter la mise en forme des données à l’utilisateur et à ses besoins. Il s’agit de démultiplier le pouvoir de médiation des cartes de l’anthropocène.
En savoir plus