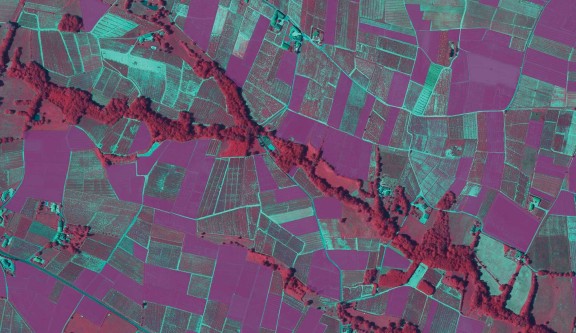Autour de la Terre
« Une autre forme d’urbanité est possible »
Entretien avec le géographe Michel Lussault qui s’appuie, dans son nouveau livre, sur les philosophies du « care » pour esquisser de nouvelles manières de vivre, d’habiter et de cohabiter dans un monde toujours plus urbain.
Publié le 17 janvier 2025
Temps de lecture : 7 minutes
Dans votre dernier livre intitulé « Cohabitons ! Pour une nouvelle urbanité terrestre », vous expliquez que nous serions arrivés dans l’ère de « l’Urbanocène ». Qu’entendez-vous par là ?
Pour les théoriciens de l’Anthropocène, nous sommes entrés dans une nouvelle période géologique vers la fin du XVIIe siècle. Les débuts de l’époque industrielle marquent le moment où l’espèce humaine est devenue une force de la nature capable de rivaliser avec les autres par ses impacts sur le système-Terre dans son ensemble.
Je travaille depuis 40 ans sur les phénomènes urbains et je me suis demandé si cette force capable de rivaliser avec les autres forces géologiques ne se manifestait pas en grande partie à travers l’urbanisation planétaire. L’urbanisation a en effet bouleversé notre planète jusqu’à menacer sa « zone critique », c’est-à-dire le lieu où se situent les interactions entre les systèmes vivants et non vivants – en somme, une zone réactive pour la planète qui joue un rôle clé dans la régulation globale de la Terre, et que l’homme n’a cessé de modifier ces dernières décennies pour ses activités économiques. Cette zone critique est ce qui garantit l’habitabilité du vivant et pourtant, elle est sans cesse bouleversée par l’urbanisation.
D’où la nuance que je propose : en fin de compte, l’Anthropocène ne prendrait-il pas la forme aujourd’hui d’un Urbanocène ? Ce dernier serait à l’origine de la transformation de notre planète et responsable d’une crise de l’habitabilité de cette dernière.
Sous quelles formes se manifeste cette crise de l’habitabilité ?
Je pense à notre condition face à la menace du réchauffement climatique, qui met nos villes à rude épreuve. Mais aussi à un épisode comme celui de la pandémie de Covid-19, où il a fallu quelques semaines seulement pour nous rappeler notre vulnérabilité alors que nous pensions être protégés de tout risque. La pandémie a par exemple rappelé combien nos logements étaient devenus inconfortables et exigus, au détriment du confort de leurs habitants.
Le constat qui en découle est que ce système global est en réalité très fragile, que nous nous sommes inscrits dans un imaginaire collectif où tous nos problèmes sont réglés par deux choses : la première, c’est la puissance économique ; la seconde, c’est la puissance technologique. A travers cette vision, nous mettons de côté l’idée que nos habitats sont fragiles et vulnérables.
Dans mon livre, je plaide pour que nous acceptions cette vulnérabilité, que nous changions de référentiel dans la façon dont nous produisons nos villes en m’appuyant sur une philosophie qui m’a bouleversé, à savoir la philosophie « care » - littéralement « prendre soin » en anglais.
Vous introduisez un nouveau terme : « le géo-care ». En quoi cela consiste-t-il ?
La philosophie du « care », popularisée entre autres par la politologue américaine Joan Tronto, part du principe que tout être vivant est vulnérable. Alors que notre vision de l’urbain promeut la lutte de chacun pour être le plus fort, la philosophie du « care » insiste sur la coopération. Alors que les idées actuelles promeuvent l’autonomie et l’individualisation, cette philosophie promet l’interdépendance en expliquant que l’individu ne détient jamais seul toutes les clés d’une solution. Ma démarche est simplement de se demander s’il peut exister un équivalent dans le monde de l’urbain, c’est ce que je nomme un « géo-care », autrement dit une façon de maintenir, de perpétuer et de réparer notre habitat, de sorte que nous puissions vivre aussi bien que possible et de façon juste sur cette planète. Pour y parvenir, je m’appuie sur quatre vertus que je qualifie de cohabitantes : la considération, l’attention, le ménagement et la maintenance.
 Jardins de Singapour © Jasckal
Jardins de Singapour © Jasckal
Comment appliquer ces vertus au sein de nos politiques urbaines ?
La considération est une vertu dont nos politiques urbaines manquent cruellement. Certaines personnes et populations deviennent même caractérisées essentiellement par leur déconsidération, celles que l’anthropologue Michel Agier analyse sous le vocable commun des « indésirables » : c’est le cas des sans-abris, des réfugiés, des migrants… Ce constat vaut également pour les végétaux ou les animaux, que nous considérons comme des objets dont nous n’avons pas besoin de nous soucier dans nos politiques urbaines. D’autres formes d’urbanisme ont pourtant tenu compte par le passé de ces « indésirables » et leur ont même octroyé des droits.
Je m’appuie beaucoup sur les exemples des peuples premiers dans cet ouvrage, car ils ont des récits alternatifs qui peuvent nous inspirer. Je développe en particulier celui des droits du « riz sauvage » manoomin – nom venant de la langue ojibwe, parlée par le peuple autochtone éponyme, appartenant à la nation Chippewa, originaire des lacs et des rivières de la région des Grands Lacs et du Canada. Ce riz sauvage, qui est en réalité une herbacée, était un aliment de base pour de nombreuses nations amérindiennes. En décembre 2018, l’instance officielle représentant les intérêts de la tribu a adopté une « loi tribale » reconnaissant les droits juridiquement exécutoires du manoomin (dont le droit à une eau saine et à un environnement non pollué, NDLR). En s’appuyant sur ce droit, la tribu a déposé en août 2021 une plainte afin d’empêcher à l’État du Minnesota de délivrer un permis d’utilisation de l’eau à une entreprise pétrolière....
« Ma démarche est de se demander s’il peut exister un « géo-care », autrement dit une façon de maintenir, de perpétuer et de réparer notre habitat. Pour y parvenir, je m’appuie sur quatre vertus que je qualifie de cohabitantes : la considération, l’attention, le ménagement et la maintenance. »
Vous proposez de « ménager » le territoire… qu’entendez-vous par là ?
Nous manquons de ménagement. Le terme est riche de sens si on le comprend en extension : respecter l’intégrité d’une chose, de soi ou d’une personne. Je m’explique : depuis les années 60, l’urbanisme et l’aménagement reposent sur l’idée de la valorisation économique et immobilière d’un lieu. Suivant cette logique, ingénieurs et architectes sont au service de l’urbanisation tandis que les habitants et leurs habitats sont une variable d’ajustement. Les habitats existants sont souvent marginalisés dans ces projets d’aménagement - quand ils ne sont pas totalement effacés. Je montre dans mon livre qu’il est pourtant possible de penser d’autres formes d’urbanisation. Je parle de l’exemple du quartier libre des Lentillères à Dijon : neuf hectares de terres maraîchères sont occupés de manière illégale depuis 2010. Ces terrains à fort potentiel de constructibilité sont convoités de longue date par la métropole qui souhaite y construire un nouvel écoquartier. Les occupants dénoncent, eux, la spéculation foncière et l’accaparement de terres productrices qui contribuent au maintien des écosystèmes sur leur lieu de vie.
Le ménagement n’est pas la seule vertu qui nous fait défaut. Nos politiques d’aménagement sont aussi déficientes en matière d’attention. La solidarité et l’attention se sont exercées dans le cadre restreint de la famille, des proches amis, parfois, beaucoup plus rarement des voisins immédiats, alors que ces vertus gagneraient à être appliquées à l’échelle urbaine. Et je parle aussi dans l’ouvrage du manque de promotion de la vertu de maintenance. Je prends l’exemple dans mon livre, des ateliers de réparation à vélo, qui à contrecourant de cette idée du tout jetable, promeuvent la réparation et la maintenance et qui s’attèlent, à rebours de nos politiques urbaines dominantes, à « ménager » le lieu où ils vivent.
Il me semble que pour qu’un projet urbain soit réussi, ces quatre vertus doivent être à l’œuvre. Et elles nous montrent, d’une certaine façon, qu’il faut considérer l’expertise habitante. L’inverse est aussi vrai : si les opérateurs s’appuient sur l’habitant, ce dernier doit cesser de se conduire comme le client d’un service, mais comme un citoyen à part entière.
En fin de compte, faut-il changer notre façon de « raconter » l’urbain ?
J’étends le concept de « globalisation », terme initialement utilisé pour désigner la mondialisation de l’économie et désigner un espace où les marchandises circulent librement, au phénomène d’urbanisation. Prenez l’exemple de la « ville-Monde », qui est l’incarnation de cette globalisation de l’urbain : partout où vous allez dans une grande métropole, vous retrouverez les mêmes gratte-ciels, les mêmes biens et services, les mêmes activités récréatives et les mêmes technologies urbaines. Dubaï, Toronto, les villes chinoises… sont autant d’exemples que je détaille dans mon livre.
Mais le développement de l’urbanisation et de ces standards ne se limite pas aux métropoles. Si vous allez dans le désert du Sahara ou dans une forêt reculée de l’Amazonie, vous trouverez des traces de microplastiques ou d’autres pollutions. L’urbain est présent partout même si les traces sont plus ou moins visibles, et nous ne pouvons pas l’effacer d’un coup de baguette magique. Ceux qui affirment que nous pouvons faire marche arrière ont tort. D’où mon constat, qui est de dire : nous n’avons pas d’autre choix que de partir du milieu urbain et de le changer de l’intérieur si nous voulons offrir une meilleure habitabilité à notre planète.
Les modèles prônés par la « ville-Monde » s’appuient sur une logique de domination, de puissance et de compétitivité entre les villes. Je crois profondément qu’il faut sortir du récit qui nous est servi en permanence et qu’il faut essayer de raconter d’autres histoires. Les questions que nous devons nous poser, sont les suivantes : est-ce que nous sommes capables de changer nos langages, d’admettre que nos modèles sont dans une impasse et que pour que la société soit prospère, il nous faut partager nos richesses ? Est-ce que nous sommes capables de projeter d’autres histoires urbaines face à un développement tous azimuts ? Mon propos peut être qualifié d’idéaliste, mais il faut reconnaitre qu’en matière d’urbain, nous avons jusqu’à présent pensé le confort pour nous-mêmes au détriment des autres…
Propos recueillis par Emmanuelle Picaud

Géographe, professeur d’études urbaines à l’université de Lyon (École normale supérieure de Lyon) et fondateur en 2017 de l’Ecole urbaine de Lyon, Michel Lussault est l’auteur notamment de L’Homme spatial (Seuil, 2007) et de L'Avènement du Monde. Essai sur l'habitation humaine de la terre (Seuil, 2013) et d’Hyper-Lieux (Seuil, 2017). Son dernier livre, Cohabitons ! Pour une nouvelle urbanité terrestre (Seuil), a été publié en octobre 2024.
Mis à jour 25/03/2025