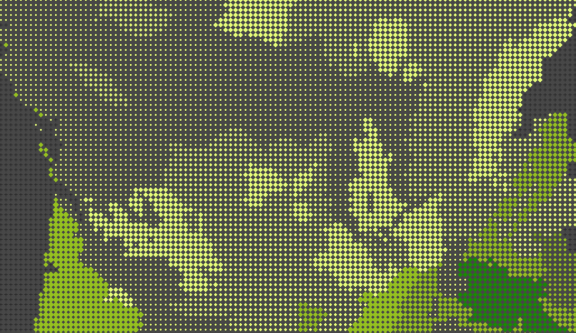Balade en forêt
Comment dresse-t-on le portrait-robot de la forêt française ?
Près d’un tiers du territoire métropolitain est couvert de forêt. Ce patrimoine d’une grande diversité biologique place la France quatrième dans le classement des États européens les plus boisés. Mais que sait-on vraiment de l’état de nos forêts ? Et comment produit-on les données de référence à leur sujet ? Entrez dans les coulisses des statistiques forestières…
Publié le 08 décembre 2021
Temps de lecture : 15 minutes

Depuis 2017, l'enquête de l'Inventaire forestier national figure parmi les enquêtes officielles à caractère obligatoire, reconnues d’intérêt général et de qualité statistique, au même titre que le recensement de la population par exemple. Ce label du Conseil national de l'information statistique est une garantie de qualité, d'objectivité et de protection de la vie privée.

Le photo-interprète, cartographe de la forêt
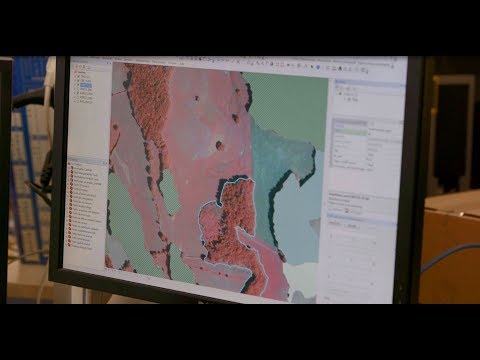
En cliquant sur lecture, vous acceptez les cookies provenant de YouTube
L’agent de terrain, collecteur des données forestières

En cliquant sur lecture, vous acceptez les cookies provenant de YouTube
L’ingénieur d’études, le coordonnateur des projets forêt-bois

En cliquant sur lecture, vous acceptez les cookies provenant de YouTube
Mis à jour 17/12/2025